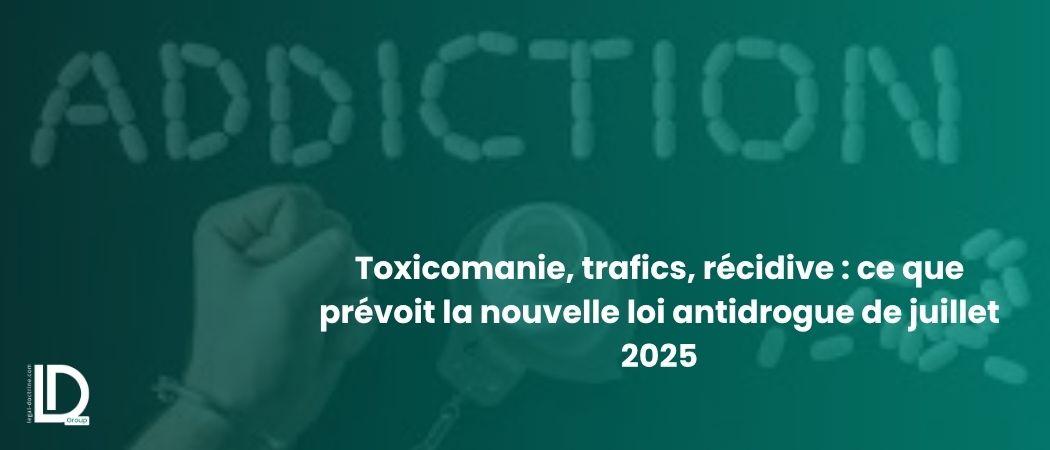Face à la montée préoccupante de la consommation, de la banalisation et du trafic de stupéfiants en Algérie — notamment chez les jeunes, les élèves et dans les milieux urbains fragiles — les autorités publiques ont décidé de renforcer de manière significative l’arsenal législatif existant. Cette évolution traduit une volonté claire de mettre fin à une dynamique alarmante, qui menace à la fois la cohésion sociale, la santé publique, et l’ordre républicain.
Dans ce contexte, l’État algérien a promulgué la Loi n° 25-03 du 1er juillet 2025, modifiant et complétant la Loi n° 04-18 du 25 décembre 2004, qui constitue jusqu’à aujourd’hui la pierre angulaire du dispositif juridique en matière de prévention et répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Cette réforme législative se veut à la fois préventive, curative et répressive. Elle élargit le champ d’intervention de l’État sur plusieurs fronts : dépistage systématisé, prise en charge médicale, réinsertion sociale, sanctions aggravées pour les trafics organisés, et dispositifs de contrôle renforcés dans les établissements scolaires, professionnels et pénitentiaires.
Elle s’inscrit dans une logique de sécurité nationale, face aux enjeux transfrontaliers du trafic de drogue, mais aussi de réhabilitation sociale et de modernisation institutionnelle, en adaptant les lois aux réalités contemporaines : trafics numériques, drogues synthétiques, et utilisation de mineurs dans les réseaux criminels.
À travers cette réforme, l’Algérie affiche donc sa volonté de protéger les générations futures, garantir la souveraineté de ses institutions et restaurer un climat de confiance et de sécurité au sein de la société.
Ce qui change : résumé des principales nouveautés
Obligation de tests de dépistage pour les candidats à l’embauche dans le secteur public et privé
L’une des principales innovations de la réforme réside dans l’introduction d’un dépistage obligatoire des stupéfiants et substances psychotropes pour toute personne postulant à un emploi, que ce soit dans la fonction publique, les entreprises d’État, les organismes à but non lucratif, ou encore dans le secteur privé. Ce test devient désormais une pièce exigée dans le dossier administratif du candidat lors d’un concours de recrutement. Cette mesure vise à prévenir l’entrée de personnes toxicomanes dans le monde professionnel, à promouvoir un environnement de travail sain, et à lutter contre l’usage caché de stupéfiants en milieu professionnel.
Encadrement légal du dépistage dans le milieu scolaire
La nouvelle loi autorise l’intégration encadrée de tests de dépistage lors des examens médicaux périodiques organisés dans les établissements scolaires. Cette disposition est toutefois soumise à l’autorisation préalable des représentants légaux de l’élève ou du juge des mineurs, garantissant le respect des droits de l’enfant. Si une consommation est détectée, aucune sanction pénale n’est appliquée. En revanche, une prise en charge médicale immédiate est prévue, afin de traiter précocement l’addiction et d’éviter que la consommation ne devienne chronique. L’objectif est clairement préventif et vise la protection de la jeunesse.
Renforcement significatif des peines pour les infractions les plus graves pouvant aller jusqu’à la peine de mort.
La loi prévoit un durcissement des sanctions pénales, notamment pour les crimes considérés comme aggravés : trafic dans les établissements éducatifs ou hospitaliers, implication de mineurs, appartenance à des groupes criminels organisés ou transnationaux, ou encore cas où l’usage de stupéfiants entraîne la mort d’autrui. Dans ces situations, la peine de mort peut désormais être prononcée. Ce renforcement vise à dissuader les trafiquants les plus dangereux et à protéger les populations vulnérables exposées au trafic.
Introduction de nouvelles sanctions patrimoniales, pénales et sociales
La réforme ne se limite pas à l’emprisonnement. Elle introduit des sanctions supplémentaires affectant la situation personnelle, patrimoniale et juridique des auteurs d’infractions :
- Confiscation des biens issus directement ou indirectement du trafic (même à titre conservatoire, dès l’enquête) ;
- Interdiction de séjour sur le territoire algérien pour les étrangers condamnés (temporaire ou définitive) ;
- Déchéance de la nationalité algérienne acquise pour les personnes naturalisées impliquées dans des crimes graves liés aux stupéfiants.
Ces mesures traduisent une volonté de frapper au portefeuille et à l’identité les personnes impliquées dans ce type de criminalité.
Mise en place d’outils renforcés de prévention, de prise en charge médicale et de réinsertion sociale
La loi introduit une série de dispositifs visant à accompagner les personnes en situation de dépendance ou sortant de prison. Ces mesures comprennent :
- Un suivi post-pénal encadré par les services de réinsertion, à la demande de l’ex-détenu ;
- La possibilité de traitement médical imposé par décision judiciaire, avec désignation de l’établissement de soins ;
- Un rôle accru des collectivités locales, établissements de santé, et autorités judiciaires dans la coordination du parcours de soin et de réinsertion.
Cette approche globale vise à éviter la récidive, tout en offrant une seconde chance encadrée aux toxicomanes repentis.
Facilitation des enquêtes financières et de la coopération intersectorielle
Pour renforcer l’efficacité de la lutte contre les réseaux de trafic, la réforme donne aux autorités judiciaires et aux services d’enquête la possibilité de :
- Mener des enquêtes financières parallèles, pour identifier les circuits de blanchiment d’argent ;
- Saisir les avoirs du suspect dès l’ouverture d’une procédure ;
- Publier l’identité ou la photo de suspects dans certains cas, afin d’aider à leur arrestation ou d’éviter la réitération de l’infraction ;
- Impliquer plusieurs secteurs (justice, santé, éducation, médias, collectivités) dans une stratégie nationale de lutte contre la drogue.
- Ces nouveaux leviers opérationnels traduisent une volonté claire de mieux détecter, poursuivre et démanteler les réseaux, en mobilisant toutes les forces de l’État.
Analyse détaillée des évolutions
1. Prévention et sensibilisation : une approche globale
L’introduction de l’article 2 bis élargit l’objectif de la loi, en affirmant une stratégie multidimensionnelle :
- Préserver la sécurité nationale.
- Protéger la santé publique, avec un accent sur la prise en charge médicale et psychologique.
- Impliquer les établissements éducatifs, les médias et la société civile dans les actions de prévention.
- Renforcer la coordination entre les différents secteurs de l’État.
2. Nouveauté majeure pour les ressources humaines : dépistage obligatoire à l’embauche
L’article 5 bis 9 impose désormais :
« Des tests de dépistage négatifs aux stupéfiants et/ou substances psychotropes » dans les dossiers des candidats aux concours de recrutement, y compris dans le secteur privé.
Cela implique une nouvelle exigence administrative et médicale dans tout processus de sélection, en attente de précisions réglementaires (types de tests, fréquence, laboratoires agréés, durée de validité, etc.).
Impact direct pour les RH : adaptation des procédures de recrutement et mise en conformité légale rapide.
3. Dépistage scolaire encadré
L’article 5 bis 10 autorise, avec accord des représentants légaux ou du juge pour mineurs, le dépistage précoce chez les élèves lors d’examens médicaux périodiques.
- En cas de test positif, seule une prise en charge médicale est prévue : pas de poursuites judiciaires.
- Cette mesure vise à intervenir avant l’installation d’une addiction durable.
4. Réinsertion post-pénale encadrée
L’article 5 bis 11 renforce l’accompagnement des anciens détenus condamnés pour des infractions liées aux stupéfiants :
- Suivi post-libération à leur demande.
- Coordination entre services pénitentiaires, autorités judiciaires, établissements spécialisés et collectivités locales.
5. Renforcement de la prise en charge médicale
Les articles 10, 10 bis et 10 bis 1 précisent le rôle :
- Du magistrat dans la désignation des établissements de soins.
- Du médecin dans la transmission de rapports médicaux.
- Des juridictions dans le suivi post-traitement, jusqu’à un an de surveillance médicale.
6. Répression plus sévère des crimes graves
Les articles 16 bis 2, 21 bis, 21 bis 1 et 21 bis 2 introduisent des sanctions lourdes :
- Peine de mort pour certaines infractions aggravées (ex : usage de stupéfiants ayant entraîné des morts, trafic en milieu scolaire, appartenance à un groupe criminel transnational).
- Peines renforcées en cas de trafic de drogues synthétiques.
- Création de délits spécifiques de blanchiment d'argent lié au trafic.
7. Atteintes à la nationalité et au séjour
- L’article 24 autorise l’interdiction de séjour pour les étrangers condamnés.
- L’article 24 bis permet la déchéance de la nationalité algérienne acquise pour les auteurs de crimes liés aux stupéfiants.
8. Infractions commises sous influence : aggravation automatique des peines
L’article 26 bis prévoit que toute infraction commise sous l’effet de stupéfiants entraîne l’application de la peine maximale prévue par la loi.
Le refus de se soumettre à des examens médicaux pour établir l'état d'influence constitue également une infraction pénalement punissable.
9. Récidive : sanctions alourdies par modification de l’article 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004
La loi n° 25-03 du 1er juillet 2025 modifie l’article 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004, en y introduisant une échelle de peines renforcées en cas de récidive.
Ce nouvel article 27 prévoit qu’en cas de récidive pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, les peines encourues sont systématiquement aggravées. Par exemple :
- La peine de mort est prononcée si l'infraction initiale est punie de la réclusion criminelle à perpétuité ;
- La réclusion criminelle à perpétuité est encourue si la peine initiale allait de 20 à 30 ans ;
- Une réclusion criminelle de 20 à 30 ans remplace les peines de 10 à 20 ans d’emprisonnement ;
- Et ainsi de suite, jusqu’au doublement des peines pour les infractions de moindre gravité.
Cette gradation vise à dissuader les récidivistes en instaurant un régime de sanctions automatiques et progressives. Elle s’inscrit dans une logique de tolérance zéro envers la répétition des actes liés au trafic ou à la consommation illégale de stupéfiants.
10. Mesures patrimoniales et symboliques : renforcement des moyens d’action économique et médiatique
La réforme introduit, à travers les articles 34 bis, 34 bis 1, 35 bis 1 et 36 bis 2 ajoutés à la loi n° 04-18 de 2004, un arsenal élargi de mesures patrimoniales et symboliques visant à mieux sanctionner, dissuader et tracer les flux financiers illicites liés aux stupéfiants. Ces mesures visent non seulement les auteurs d’infractions, mais aussi leur environnement économique.
a) Saisie des biens du suspect dès l’enquête (article 34 bis)
Le nouvel article 34 bis autorise le ministère public, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement à :
- Enquêter sur l’origine des biens mobiliers et immobiliers du suspect, qu’ils soient situés en Algérie ou à l’étranger ;
- Imposer une interdiction de sortie du territoire national (interdiction de voyager) pendant la durée de l’enquête ;
- Procéder à la saisie conservatoire de ces biens, qui ne sera levée que :
- Si l’affaire aboutit à un non-lieu ou un acquittement ;
- Ou après jugement définitif (condamnation ou confiscation).
Ces mesures visent à empêcher la dissipation des avoirs illicites issus du trafic avant l’issue de la procédure judiciaire.
b) Publication de l’identité des suspects (article 34 bis 1)
L’article 34 bis 1 autorise désormais le parquet à publier, dans les cas graves ou flagrants :
- La photographie des suspects ;
- Ou tout autre élément d’identité (nom, signalement, etc.).
Cette publication est strictement encadrée et justifiée par des nécessités précises :
- Préservation de l’ordre public ;
- Prévention de la réitération des infractions ;
- Facilitation de l’arrestation des suspects en fuite.
Il s’agit d’un outil de pression publique mais aussi de collaboration sécuritaire.
c) Intéressement des informateurs (article 35 bis 1)
L’article 35 bis 1 introduit une nouveauté majeure : la possibilité d’accorder des récompenses pécuniaires ou autres aux personnes qui :
- Fournissent des informations utiles aux autorités compétentes ;
- Permettent l’arrestation d’auteurs d’infractions ou la prévention d’un trafic en cours.
Les modalités d’attribution (montant, conditions, confidentialité, organes compétents) seront précisées par voie réglementaire.
L'objectif est d’encourager la dénonciation active et renforcer l’intelligence criminelle, notamment en milieu fermé (établissements, réseaux, etc.).
d) Enquêtes financières parallèles autorisées (article 36 bis 2)
Enfin, l’article 36 bis 2 habilite expressément :
- Les officiers de police judiciaire (OPJ) ;
- Et les organes d’enquête spécialisés,
à conduire des enquêtes financières parallèles à l’enquête principale. Cela permet de :
- Identifier les avoirs issus du trafic (comptes bancaires, biens, investissements, etc.) ;
- Traquer les circuits financiers liés au blanchiment d’argent de la drogue.
Cette approche vise une répression économique ciblée, complémentaire à la réponse pénale classique.
Avec la Loi n° 25-03 du 1er juillet 2025, l’Algérie engage un virage sécuritaire, sanitaire et éducatif dans sa lutte contre les stupéfiants. En imposant de nouvelles obligations (comme le dépistage à l’embauche), en renforçant la prise en charge médicale et en alourdissant les peines pour les trafiquants, l’État cherche à prévenir, soigner et réprimer, tout à la fois.
Pour les professionnels RH, les établissements scolaires, les services médicaux et les institutions judiciaires, cette réforme implique une adaptation rapide des pratiques, une coordination accrue et un effort de formation juridique et opérationnelle pour s’aligner sur ce nouveau cadre légal.
Vous êtes abonné ? Restez à jour en consultant les notes, communiqués et circulaires ainsi que l’ensemble des Codes en vigueur sur Legal Doctrine.
Restez à l’affût des dernières actualités juridiques en vous abonnant à notre newsletter Legal Doctrine.