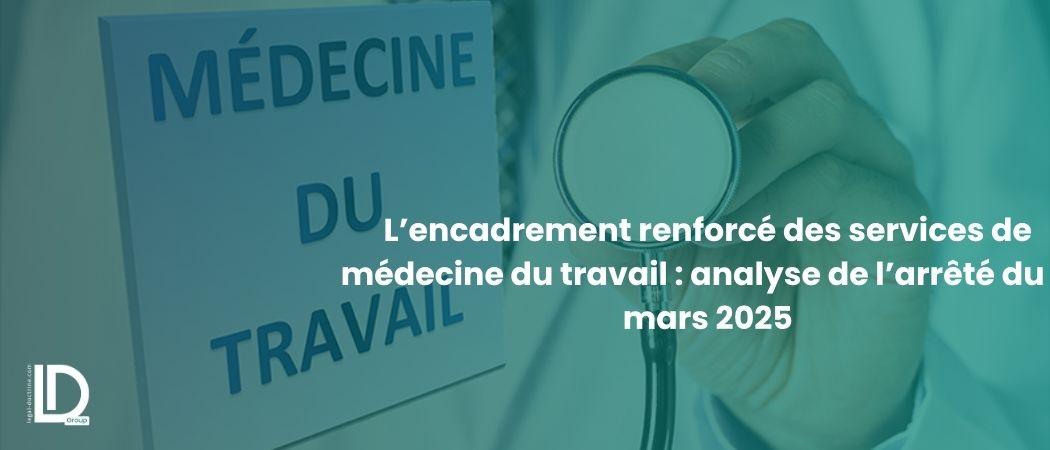La médecine du travail en Algérie repose sur un socle juridique ancien, remontant notamment au décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993, qui a organisé les fondements du suivi médical des travailleurs et de la prévention des risques professionnels. Dans un contexte marqué par l’industrialisation croissante et la diversification des secteurs d’activité, ce dispositif visait à protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment à travers des examens médicaux périodiques, des actions de sensibilisation et un suivi des conditions de travail.
En 2001, un premier arrêté avait fixé les normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipements pour les services de médecine du travail. Il s’agissait de l’arrêté du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001, qui est explicitement abrogé par l’article 9 de l’arrêté du 11 mars 2025.
C’est ce texte de 2001 qui fixait jusqu’à récemment les normes applicables en matière de moyens humains, de locaux et d’équipements des services de médecine du travail. Il s’agissait donc de la principale référence réglementaire dans ce domaine pendant plus de deux décennies, avant d’être remplacé par celui de 2025.
Mais les évolutions rapides des pratiques professionnelles, les nouveaux risques sanitaires (chimiques, biologiques, psychosociaux) et les exigences accrues en matière de qualité de prise en charge ont rendu ce texte progressivement obsolète.
C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêté du 11 mars 2025, qui vient abroger l’arrêté de 2001 et fixer un cadre actualisé, plus exigeant, plus adapté aux réalités actuelles. Pris en application de l’article 11 du décret exécutif de 1993, ce nouveau texte actualise les normes selon une approche différenciée, tenant compte du niveau d’exposition des travailleurs, de la nature de la structure médicale (publique, privée ou inter-organismes), et de l’objectif de garantir une médecine du travail moderne, préventive et accessible à tous.
Des moyens humains calibrés selon les risques professionnels et la structure du service
L’arrêté distingue deux types de structures en matière de médecine du travail : celles intégrées aux organismes employeurs (autonomes, inter-organismes ou privées) et celles rattachées aux établissements publics de santé. Pour chaque type, des seuils précis sont fixés concernant les ressources humaines minimales.
Dans les structures de médecine du travail autonomes ou inter-organismes, un médecin du travail à temps plein est requis pour 1730 travailleurs exposés à des risques professionnels élevés, et un pour 2595 travailleurs moyennement ou peu exposés. Le nombre d’infirmiers varie selon les effectifs, allant d’un à plusieurs, avec une grille progressive à partir de 200 travailleurs fortement exposés ou 500 pour les moins exposés. Un secrétaire médical est également obligatoire pour ces structures.
Pour les services relevant des établissements publics de santé, le personnel requis est renforcé : deux médecins du travail, un infirmier, un hygiéniste, un psychologue clinicien, un biologiste, et un secrétaire médical. Cette organisation plus étoffée traduit une volonté d’assurer une prise en charge globale, intégrant aussi bien la prévention médicale que le suivi psychologique et environnemental.
Une exigence accrue en matière de locaux médicaux fonctionnels
Les normes de locaux établies par l’arrêté visent à garantir des conditions de consultation, de soins et d’examens adaptées aux besoins des travailleurs. Chaque médecin du travail à temps plein doit disposer de son propre cabinet médical. Le service doit comprendre au minimum : une salle de soins, une salle d’investigations complémentaires, une salle d’attente, un secrétariat médical, une salle d’archives, des installations sanitaires, une salle de réunion, et un bureau pour le psychologue clinicien.
Le texte insiste sur le fait que les principales salles (cabinet médical, salle de soins et salle d’investigations) doivent être contiguës, afin d’assurer un circuit de soins fluide. Une salle d’observation équipée d’un lit médicalisé est également exigée. Si elle n’est pas disponible, la salle de soins peut remplir cette fonction, à condition qu’elle soit proche des autres locaux médicaux pour permettre une surveillance efficace.
Des précisions sont aussi apportées dans l’annexe jointe, notamment sur les dimensions minimales (16 m² pour le cabinet médical) et les aménagements indispensables comme un point d’eau, une table d’examen, ou encore un accès facilité pour les personnes en situation de handicap.
Un équipement standardisé garant d’un suivi médical complet et efficace
L’arrêté établit un socle d’équipements obligatoires permettant de réaliser l’ensemble des examens nécessaires à la médecine du travail. Chaque cabinet doit être équipé du matériel d’examen clinique de base, d’une toise, d’un pèse-personne, de tests visuels (échelles optométriques), d’un négatoscope, ainsi que de dispositifs pour la conservation sécurisée des dossiers médicaux.
L’accent est mis sur la nécessité de disposer d’équipements de diagnostic fonctionnel, tels que des appareils de mesure de la fonction respiratoire, auditive, visuelle et cardiaque, adaptés aux risques spécifiques des postes de travail. Des instruments de mesure de l’environnement de travail, comme un sonomètre (niveau sonore) et un luxmètre (niveau d’éclairement), sont également requis.
L’équipement informatique est aussi prévu dans les normes, incluant le matériel de bureautique et un accès à internet sécurisé, afin de garantir la confidentialité des données. Pour les services stockant des vaccins ou des réactifs, un réfrigérateur médical relié à un groupe électrogène est obligatoire, tout comme une source d’oxygène pour les soins d’urgence.
Vous êtes abonné ? Restez à jour en consultant les notes, communiqués et circulaires ainsi que l’ensemble des Codes en vigueur sur Legal Doctrine.
Restez à l’affût des dernières actualités juridiques en vous abonnant à notre newsletter Legal Doctrine.