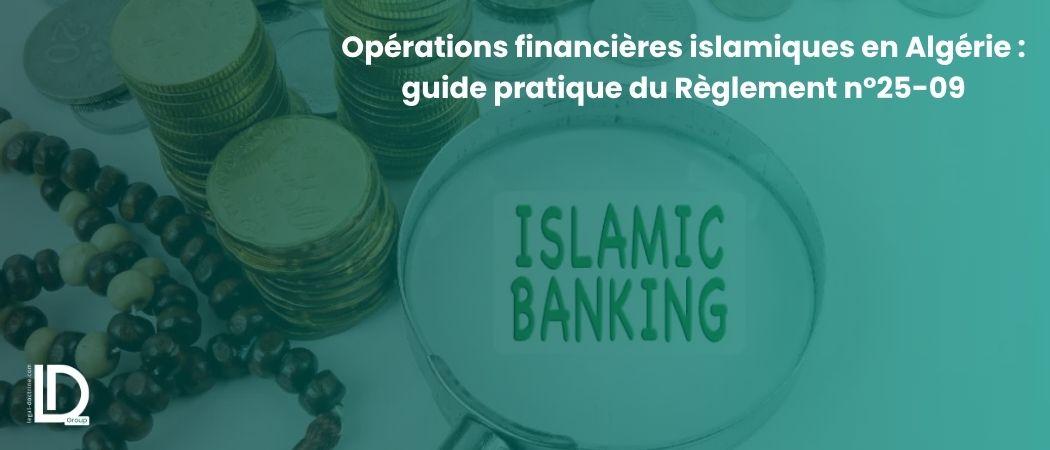Le secteur bancaire islamique connaît une croissance rapide en Algérie. Pour assurer la conformité religieuse et la transparence financière, le Règlement n°25-09 établit des règles claires sur la comptabilisation des principaux modes de financement islamiques. Il couvre les financements basés sur le Salam, l’Istisna’a, la Moudaraba, la Moucharaka, le Qard Hassan, ainsi que la gestion des instruments financiers islamiques et des comptes d’investissement.
L’objectif est double : protéger les intérêts des clients et investisseurs, et offrir aux établissements financiers un cadre pratique et harmonisé pour enregistrer et évaluer leurs transactions. Ce guide synthétise les points essentiels pour comprendre comment ces opérations sont traitées comptablement, sans nécessiter de connaissances juridiques ou financières poussées.
Les financements à livraison différée : Salam et Istisna’a
Les modes de financement Salam et Istisna’a concernent des transactions où le paiement ou la livraison des biens se fait dans le futur :
- Salam : le client reçoit immédiatement le capital et s’engage à livrer un bien à une date ultérieure. L’établissement comptabilise le capital dès sa mise à disposition et valorise le bien reçu (Al-Muslam Fih) à son coût historique ou à la juste valeur. Si le bien est de qualité différente ou perdu partiellement, une provision pour perte est constituée.
- Salam parallèle : l’établissement peut revendre le bien avant la livraison au client initial. La différence entre le prix de vente et le coût du bien est enregistrée comme profit ou perte.
- Istisna’a : financement pour la production ou la construction d’un bien (ex : bâtiment, machine). Les coûts engagés (directs et indirects liés au projet) sont comptabilisés comme travaux en cours, et les revenus sont reconnus selon l’avancement du projet ou à son achèvement.
- Istisna’a parallèle : l’établissement peut faire fabriquer le bien par un sous-traitant et le livrer à un client. Les coûts et profits sont gérés de manière similaire à l’Istisna’a classique, avec attention particulière aux retards ou non-conformités, qui génèrent des provisions ou créances.
Ces modes mettent l’accent sur une évaluation prudente des biens et des profits, afin de refléter fidèlement la situation financière de l’établissement.
Les financements par partenariat : Moudaraba et Moucharaka
Ces financements reposent sur le principe du partage du risque et du profit :
- Moudaraba : l’établissement fournit le capital et le client (Moudarib) gère le projet. Les profits sont partagés selon un ratio convenu, tandis que les pertes financières sont supportées par l’établissement sauf en cas de faute du client.
- Moucharaka : l’établissement et le client investissent ensemble dans le capital d’un projet. Les profits sont partagés proportionnellement à la participation de chacun. Dans une Moucharaka dégressive, la part de l’établissement diminue progressivement au profit du client. Toute plus-value ou moins-value lors du transfert est comptabilisée en résultat.
- Les non-paiements ou fautes du client sont enregistrés comme créances.
- Les profits et pertes sont généralement enregistrés à la fin de l’exercice ou à chaque étape du projet, ce qui permet un suivi régulier et transparent des investissements.
Ce type de financement illustre la philosophie islamique de risque partagé, où ni le prêteur ni l’emprunteur ne bénéficient de manière injuste au détriment de l’autre.
Financement sans profit commercial : Qard Hassan et comptes d’investissement
- Qard Hassan : prêt sans intérêt. Le capital est enregistré au moment de sa mise à disposition. À la fin de l’exercice, le montant est évalué au coût historique, ajusté des remboursements et provisions.
- Comptes d’investissement : représentent des fonds déposés par des clients pour investir via Moudaraba ou Wakala. Selon le niveau de contrôle de l’établissement sur l’usage des fonds, ces comptes sont présentés au bilan ou hors bilan.
- Les profits non distribués sont enregistrés pour une distribution ultérieure aux investisseurs, tandis que les pertes sont imputées en priorité sur les profits non distribués puis proportionnellement aux parts respectives de l’établissement et des investisseurs.
- L’établissement peut également utiliser des réserves de lissage des profits pour stabiliser les distributions et éviter des variations importantes dues aux fluctuations du marché.
Ces mécanismes assurent une gestion transparente des investissements des clients tout en respectant les principes de justice et d’équité de la finance islamique.
Instruments financiers islamiques et conformité à la Charia
- Les Sukuk, actions et autres instruments sont classés selon leur type et leur objectif de détention.
- Les dividendes et gains sont enregistrés uniquement si le droit à les percevoir est certain et leur montant fiable.
- Les changements de modèle économique pour la gestion des investissements doivent être documentés et approuvés par l’autorité de supervision.
- Les transactions non conformes à la Charia, les paiements de charité, et les pénalités non autorisées ne sont jamais comptabilisés comme revenus mais affectés à des comptes spécifiques.
Ce cadre garantit que la comptabilité reflète à la fois la performance financière réelle et la conformité religieuse.
En définitive, le Règlement n°25-09 établit un cadre clair et structuré pour les opérations financières islamiques en Algérie. Il distingue les modes de financement, précise la comptabilisation des profits et pertes, et encadre la gestion des investissements et des comptes d’investissement.
En pratique, ce règlement permet aux établissements financiers de :
- assurer la transparence et la fiabilité des états financiers,
- gérer prudente et équitablement les risques,
- respecter les principes de la Charia, protégeant ainsi les intérêts des clients et investisseurs.
Grâce à ces règles, la finance islamique en Algérie dispose désormais d’un outil solide pour se développer de manière durable et fiable.
Vous êtes abonné ? Restez à jour en consultant les notes, communiqués et circulaires ainsi que l’ensemble des Codes en vigueur sur Legal Doctrine.
Restez à l’affût des dernières actualités juridiques en vous abonnant à notre newsletter Legal Doctrine.